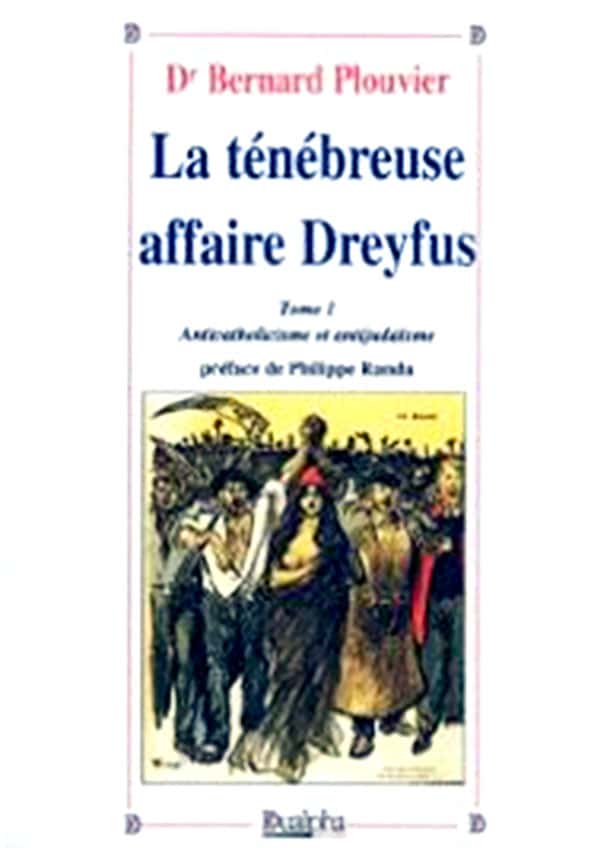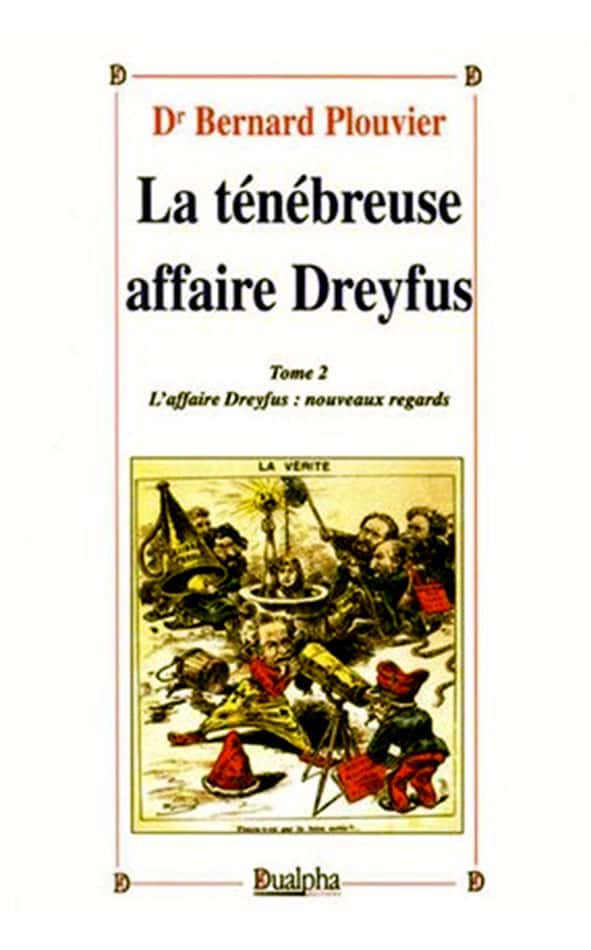Le vrai procès de Dreyfus : Rennes – 12 août-9 septembre 1899
Tout le monde le sait, et depuis longtemps, s a été victime d’une erreur judiciaire lors de son passage en Conseil de guerre, tenu à Paris du 19 au 22 décembre 1894.
L’accusation reposait, non sur de faux documents qui ne sont apparus que deux années plus tard, mais sur une pièce grotesque dans une affaire d’espionnage : un bordereau, dans lequel un « traître » envoyait à l’attaché militaire allemand en poste à Paris un récapitulatif des documents qu’il lui avait fournis et pour lesquels il avait déjà été payé. Les auteurs bien-disants ont tort d’écrire que cette pièce était « inutile » : elle était absurde, quasi-suicidaire pour son auteur.
Tout le monde ou presque, de nos jours, est convaincu que le « bordereau » n’a été écrit ni par Dreyfus, ni par Esterhazy, mais par un employé du SR (Service de renseignements) allemand sur ordre du Major Müller chef du SR allemand qui avait compris que l’attaché militaire de Paris, un noceur imbécile et homosexuel, Maximilian von Schwartzkoppen, se faisait pigeonner par un informateur qui ne lui remettait que du « pipeau » : des informations exactes, mais ou vieilles, ou inutilisables pour un Allemand.
Tout le monde ou presque, de nos jours, sait que le généralissime désigné pour le temps de guerre, le colossal Félix Saussier, héros de nombreuses campagnes, et caractériel connu qui hait à peu près tout le monde à l’état-major général de l’armée (EMG), a voulu protéger le secret du canon de 75-C auquel son frein oléopneumatique conférait une cadence de tir six à sept fois supérieure à son rival allemand, le canon de 77 au frein hydropneumatique identique à celui du 75-A et A bis que l’on exhibe sur divers lieux de combat (en Chine en 1900).
Pour désinformer (on dit à l’époque « enrosser ») le SR allemand, Saussier, orienté par le mari de sa maîtresse, Maurice Weil chassé de l’armée pour inconduite, choisit un officier décavé, flambeur et noceur, fils et neveu de deux généraux du Second Empire : Charles Esterhazy-Walsin, escroc notoire et perpétuellement désargenté. C’est l’homme idéal pour « vendre » des secrets de pacotille. En contrepartie des sommes qu’il aura perçues et pourra garder, Esterhazy reçoit l’ordre d’informer v. Schwartzkoppen qu’en matière d’artillerie de campagne, la France n’a rien de mieux que le 120 court et le 75 A, de cadence de tir identique au 77 allemand.
Mission accomplie : il faudra attendre l’été 14 et la capture des premiers 75-C par les Allemands pour que le secret de la « cadence infernale » de l’artillerie de campagne française soit percé.
Saussier a caché son initiative à tout le monde – ministre et généraux de l’EMG. Lorsque le « bordereau » arrive déchiré au 2e Bureau, ayant été volé dans une corbeille à papiers de l’ambassade allemande, c’est la panique : encore une nouvelle trahison ! Et Dreyfus, innocent, mais au très bizarre comportement, est dégradé et envoyé au bagne. On a jugé à huis clos, parce qu’il est hors question de faire savoir aux Allemands que l’on espionne leur ambassade. Saussier n’a rien dit, parce qu’il est content du scandale qui fait mousser les renseignements bidons de son « traître » et qu’on l’a informé que Dreyfus est un curieux bonhomme. À Berlin et au grand désespoir de Müller, on croit au mensonge d’Esterhazy sur l’artillerie française, par le seul fait du procès et de son énorme retentissement.
Avant d’aller plus loin, il paraît bon à l’auteur de ces lignes de s’expliquer, même si, d’après le bigot Blaise, « le moi est haïssable ». Après avoir terminé une biographie du Führer, j’avais consacré deux années à une étude sociologique de la Nation française pour expliquer – ce qui n’est pas « excuser » – la flambée d’antijudaïsme des années 1890-1910 et l’acharnement sur ce pauvre Dreyfus dont mes lectures de jeunesse m’assuraient l’innocence. Patatras ! L’étude des volumes, rapportant débats, réquisitoire et plaidoirie du second Conseil de Guerre, dont tous les bien-disants nous assurent qu’il fut « la répétition du premier » (ce qui est un colossal mensonge), a fait naître un DOUTE énorme, le même qui a entraîné la seconde condamnation de l’accusé… par un jury sélectionné exprès pour l’innocenter.
Le 25 juin 1899, le politicien-phare du « Syndicat qui n’existe pas », Pierre Waldeck-Rousseau devient Président du Conseil, flanqué au ministère de la Guerre, dans ce cabinet « de défense républicaine », de Gaston de Galliffet, héros de guerre et proche de nombreux politiciens juifs. La première occupation de ces braves gens est de ramener la paix dans l’opinion publique en innocentant Dreyfus, après la cassation de son premier jugement le 3 juin, pour (indéniable) vice de procédure du premier Conseil de guerre.
Et les services de Galliffet font tout pour assurer le triomphe de la bonne cause. Pour le site du nouveau Conseil de guerre, on choisit une ville républicaine : Rennes, qui fut un haut lieu des « bleus » au temps de la chouannerie. Pour juges, des officiers républicains, issus de Polytechnique, presque tous artilleurs, dans l’espoir que ce double esprit de corps joue en faveur de l’accusé.
Le commissaire du gouvernement est un vieux commandant de gendarmerie, Louis Carrière, qui a reçu de Galliffet l’ordre de « ne pas s’opposer aux arguments établissant la culpabilité d’Esterhazy », pourtant acquitté par un autre Conseil de guerre. Le capitaine Raffaëlli, l’envoyé spécial de Galliffet, lui a fait part de « l’invitation » du ministre à requérir l’acquittement. Galliffet se vante même de ses ingérences et fait connaître à l’Agence Havas les directives qu’il adresse au commandant Carrière ! La police – Waldeck-Rousseau est aussi ministre de l’Intérieur – ose même intimider divers témoins de l’accusation.
L’Armée française est alors extraordinairement divisée, à la fois par des haines sectaires opposant les catholiques aux francs-maçons, les républicains aux monarchistes et aux bonapartistes, sans compter les haines de Divas au sein même de chaque secte. Pour les juges, il ne s’agit pas « de protéger » l’Armée (rengaine connue) : il existe tellement de haines de clan entre les porteurs d’étoiles, que même le plus obséquieux des carriéristes aurait beaucoup de mal à se prononcer. L’unique question à traiter est celle-ci : Dreyfus a-t-il ou non « entretenu des intelligences avec une ou plusieurs puissances étrangères » ?
On ne lésine pas sur les interventions auprès des juges, relayées par le préfet d’Îlle-et-Vilaine et les envoyés ministériels, qui promettent un avancement dans leur carrière et une promotion dans l’ordre de la Légion d’honneur si l’accusé est mis hors de cause. Cela gêne tellement les juges qu’ils prennent l’avis du Premier président de la Cour de cassation, Charles Mazeau, qui les assure de leur droit de ne pas tenir compte des instructions ministérielles.
Paraît Dreyfus, pâle et squelettique. Dès qu’il s’exprime, « la sympathie s’atténue, la méfiance naît » a écrit Maurice Paléologue, né Pollack, témoin visuel et auditif ; « ses phrases sonnent faux ». Le cynique Clemenceau ose dire en aparté : « Nous avons mal choisi notre innocent ».
Pourtant, dans sa déclaration préliminaire, l’accusé prononce (mal) une fort belle phrase : « Je suis ici pour défendre mon honneur, non pour parler de mes souffrances ». Immédiatement, on se sent envahi de respect et l’on croit aussitôt aux arguments qu’une certaine littérature ressasse depuis un siècle : l’on est manifestement en présence d’un amant de l’Armée, désespéré d’avoir été repoussé dans ses offres de bons et loyaux services. Hélas, quelqu’un a pris la décision (catastrophique pour la bonne cause) de publier la version intégrale des Carnets de Dreyfus pour les années 1899-1907 (publiés en 1998) qui révèlent un individu aigri, haineux, sectaire, aux jugements grotesques : l’homme n’attirant pas la sympathie que tous les témoins ont décrite.
Et commence le défilé de ceux que l’on n’attendait pas : une cohorte de témoins surgis sans qu’on les ait sollicités.
On évoque « Dreyfus le flambeur » criblé de dettes, comme l’avait été la société Dreyfus Frères de Mulhouse en 1890, tirée d’affaire par des financiers allemands, en 1892. Tout cela n’est pas vraiment neuf, mais Dreyfus nie effrontément et sur un ton de fausset et la défense ne parvient pas à s’expliquer clairement sur ces points.
Divers témoins affirment l’existence de rapports de l’accusé en 1890-1894 avec des officiers du SR allemand en poste à Bruxelles, notamment le Major v. Schmettau, et cela est bien plus grave que les parlottes entre Esterhazy et v. Schwartzkoppen, car v. Schmettau est le chef du Bureau Ouest du SR allemand. De la même façon, on évoque des séjours secrets de Dreyfus en Alsace occupée, où il reconnaît, après dénégations initiales, avoir suivi les manœuvres de l’armée allemande près d’Altkirch… sans en avoir averti ses supérieurs parisiens, alors qu’il était élève de l’École de Guerre.
Puis l’on évoque ce que Dreyfus aurait dit en 1894 d’un « amorçage » de sa part, soit une fourniture de « documents français sans importance » pour s’en « procurer de plus importants » de la part du SR allemand. Dreyfus nie et tous les bons auteurs parlent d’affabulations de témoins.
Ce sont ces pistes belge et alsacienne qui ont fait naître chez les juges et le commissaire de la République l’intime conviction de la culpabilité de Dreyfus et non le « bordereau », sur lequel s’acharneront, au contraire, les juges de la Cour de cassation en 1904-1906, quand ils acquitteront Dreyfus sur ordre gouvernemental. À l’issue des audiences, les juges sont fort troublés. À l’évidence, Dreyfus apparaît à la fois comme un flambeur et un menteur ; les pistes belge et alsacienne, même si elles n’ont nullement été approfondies par le colonel Jouaust, le président du Conseil de guerre, ouvrent des horizons très défavorables à l’accusé.
Les auteurs consensuels ont effectué la démarche inverse de celle des juges : Dreyfus n’a jamais touché une carte de sa vie ; les pistes bizarres ne sont jamais signalées ou en passant et pour s’en gausser en deux lignes ; Lebrun-Renault est définitivement un alcoolique affabulateur à propos des « aveux » de Dreyfus. Enfin, ce procès n’est que la répétition du premier… ce qui est du pur délire !
Dans son réquisitoire du 7 septembre, le commandant Carrière résume en peu de mots et très simplement son état d’esprit. Ce faisant, il se ferme ainsi tout espoir de promotion. « Ma conviction, qui semblait s’être faite dans le sens de l’innocence au début, s’est transformée petit à petit, à l’audition des témoins… Ma conviction s’est fortifiée dans le sens de la culpabilité et aujourd’hui, en mon âme et conscience, je vous le déclare : Dreyfus est coupable ».
Il est important de bien analyser ce morceau, qui s’inscrit contre toutes les règles de la rhétorique judiciaire. Voici un procureur qui a priori pensait innocent l’accusé (c’est presque une première dans l’histoire de la Justice, mais il ne faut pas oublier que Carrière représente, dans ce procès, le ministre de la Guerre, très favorable à la défense) et qui déclare que les débats l’ont converti à la position contraire. On saura deux jours plus tard qu’il en est de même pour cinq des sept juges.
Quatre générations d’historiens se sont vengées en présentant le commandant Carrière comme un jocrisse et l’on constate qu’il s’agit d’un parfait honnête homme qui résume à la perfection en quelques lignes 29 journées d’audiences et requiert contre son intérêt personnel, pour soulager sa conscience.
Dans la soirée de ce 7 septembre, Raffaëlli informe Galliffet de la quasi-certitude de la condamnation. Immédiatement informé, Waldeck-Rousseau promet à Reinach « de saisir à nouveau la Cour de cassation ». Il a déjà promis, le 4, qu’en cas de nouvelle condamnation, Dreyfus ne serait pas une nouvelle fois dégradé publiquement ; c’est une promesse parfaitement illégale, opposée aux stipulations du Code de justice militaire.
À l’évidence, il s’est passé durant les audiences de ce procès un retournement de situation. Les juges étaient prêts à un acquittement qui leur aurait valu la reconnaissance du gouvernement. Les témoignages, l’attitude de l’accusé les ont convaincus de sa culpabilité. On ne peut les accuser de servilité : le gouvernement voulait l’acquittement. Il est absurde de reprendre l’antienne du soutien aux généraux ou du culte de la discipline : le général de Galliffet, ministre et président du Conseil Supérieur de la Guerre, exigeait l’acquittement. Voici des soldats à qui l’on a confié une mission d’acquittement, qui ont un intérêt personnel à la remplir, et qui en sont venus, naturellement, par l’effet de ce qu’ils ont perçu chez l’accusé, entendu chez les témoins, à condamner l’homme qu’ils avaient mission de blanchir.
Il existe une autre indication du désarroi né de ces débats. Maître Edgar Demange, un avocat blanchi sous le harnais, plaide le DOUTE. Depuis 2000 ans, dans la grande tradition de l’Antiquité gréco-romaine, l’on est fatigué d’entendre les avocats claironner, certifier, beugler l’innocence de leur client, non sans une débauche de figures de rhétorique. Ici, à l’issue de ces débats sur lesquels les bons auteurs n’apportent qu’un éclairage réduit et très sélectif, Demange en est réduit à plaider le doute.
N’en déplaise aux auteurs consensuels, au procès de Rennes, ce n’est pas le réquisitoire, mais la plaidoirie qui est faible. Elle occupe les journées des 8 et 9 septembre, ce qui fait beaucoup d’heures, beaucoup de mots, pour exprimer peu de choses : en l’absence de preuve, le doute doit bénéficier à l’accusé. Le commissaire du gouvernement avait dit aux juges de se fier à leur intime conviction. Le 9 septembre, après la fin de la plaidoirie, Dreyfus prend la parole et, de l’avis de tous, il s’avère lamentable.
Le verdict tombe après une heure et demie de délibérations, durant lesquelles le colonel Jouaust (qui voit les étoiles s’éloigner de son uniforme) a tenté de convaincre les autres juges. Seul le calotin Bréon de Lancran vote comme lui l’acquittement. Par cinq voix contre deux, Dreyfus est reconnu coupable d’intelligence avec une puissance étrangère. Par cinq voix contre deux (celles du commandant Profilet et du capitaine Beauvais), on lui reconnaît des circonstances atténuantes : elles ne peuvent provenir que de ses aveux, niés par les bons auteurs, c’est-à-dire une tentative d’amorçage, ce qui ferait de Dreyfus un espion amateur assez peu doué… l’on ne voit pas par quel miracle un fournisseur de renseignements deviendrait un acquéreur de renseignements autres que du matériel d’intoxication en provenance de l’étranger ou la simple indication des pôles d’intérêt de l’ennemi potentiel.
Dreyfus est condamné à dix ans de détention en forteresse. L’assistance, majoritairement dreyfusarde, accueille le verdict dans un silence sépulcral… n’y aurait-il pas, de ce côté également, un malaise certain ?
Le 12 septembre, Mathieu fait signer une demande de grâce par son frère. Elle est octroyée, « en premier gage à l’œuvre d’apaisement » par le bon Président Émile Loubet, le 19. Alfred Dreyfus quitte nuitamment la ville, où la population « républicaine » lui est très hostile ; on le fait monter dans le train de Paris à une halte de campagne.
Il faudra un minutieux « épluchage du dossier » et le silence sur toutes les pièces arrivées au SR allemand et qui n’étaient pas de l’intoxication, pour obtenir la Cassation sans renvoi du 12 juillet 1906… sur un dossier vidé (et non pas « vide ») ! Dreyfus est réintégré, promu, décoré et quitte l’armée en juin 1907. Durant la guerre, on ne l’emploiera que dans des dépôts d’artillerie ; il n’obtiendra sa promotion au grade de lieutenant-colonel qu’en septembre 1918.
Peut-on conclure, dans un sens ou dans l’autre ? Sûrement pour l’erreur judiciaire de décembre 1894. Mais le Procès de Rennes débouche sur un énorme doute, né de présomptions de collusion entre l’accusé et le SR allemand, entre ses frères restés dans le Reichsland (l’Alsace-Moselle occupée) et des intérêts allemands.
Non « la vérité n’est pas sortie du puits », elle est restée embourbée en cours de chemin. Il reste aux véritables historiens à explorer les pistes de Bruxelles, Altkirch, Saverne et Mulhouse, avant de pouvoir refermer ce dossier, en ayant conclu dans un sens ou un autre.
Un être d’exception, le plus grand des fils des hommes, un Juif de Galilée, a dit : « C’est aux fruits qu’on juge l’arbre ». La « révolution dreyfusienne », si elle n’a pas accouché du sionisme (encore une rengaine), qui se portait déjà fort bien avant elle, a procuré à la nation française le plaisir douteux de goûter à l’abjection « radicale-maçonnique », dont on reconnaît volontiers qu’elle était le régime idéal pour le « français moyen », tel que l’a défini le grotesque et suffisant Édouard Herriot durant l’entre-deux-guerres.
La passion seule fait les grandes époques, soulevant l’enthousiasme et transcendant les souffrances d’un peuple. De la très mystérieuse affaire Dreyfus aurait pu sortir du bien pour la Nation française ; ce ne fut pas le cas.
Anticatholicisme et antijudaïsme (La ténébreuse affaire Dreyfus, tome 1), Bernard Plouvier, préface de Philippe Randa, éditions Dualpha, collection « vérités pour l’Histoire », 498 pages, 31 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.
L’affaire Dreyfus : nouveaux regards (La ténébreuse affaire Dreyfus, tome 2), Bernard Plouvier, préface de Philippe Randa, éditions Dualpha, collection « vérités pour l’Histoire », 334 pages, 35 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.
EuroLibertés : toujours mieux vous ré-informer … GRÂCE À VOUS !
Ne financez pas le système ! Financez EuroLibertés !
EuroLibertés ré-informe parce qu’EuroLibertés est un média qui ne dépend ni du Système, ni des banques, ni des lobbies et qui est dégagé de tout politiquement correct.
Fort d’une audience grandissante avec 60 000 visiteurs uniques par mois, EuroLibertés est un acteur incontournable de dissection des politiques européennes menées dans les États européens membres ou non de l’Union européenne.
Ne bénéficiant d’aucune subvention, à la différence des médias du système, et intégralement animé par des bénévoles, EuroLibertés a néanmoins un coût qui englobe les frais de création et d’administration du site, les mailings de promotion et enfin les déplacements indispensables pour la réalisation d’interviews.
EuroLibertés est un organe de presse d’intérêt général. Chaque don ouvre droit à une déduction fiscale à hauteur de 66 %. À titre d’exemple, un don de 100 euros offre une déduction fiscale de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 euros.
Philippe Randa,
Directeur d’EuroLibertés.
Quatre solutions pour nous soutenir :
1 : Faire un don par virement bancaire
Titulaire du compte (Account Owner) : EURO LIBERTES
Domiciliation : CIC FOUESNANT
IBAN (International Bank Account Number) :
FR76 3004 7140 6700 0202 0390 185
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFRPP
2 : Faire un don par paypal (paiement sécurisé SSL)
Sur le site EuroLibertés (www.eurolibertes.com), en cliquant, vous serez alors redirigé vers le site de paiement en ligne PayPal. Transaction 100 % sécurisée.
3 : Faire un don par chèque bancaire à l’ordre d’EuroLibertés
à retourner à : EuroLibertés
BP 400 35 – 94271 Le Kremlin-Bicêtre cedex – France
4 : Faire un don par carte bancaire
Pour cela, téléphonez à Marie-France Marceau au 06 77 60 24 99