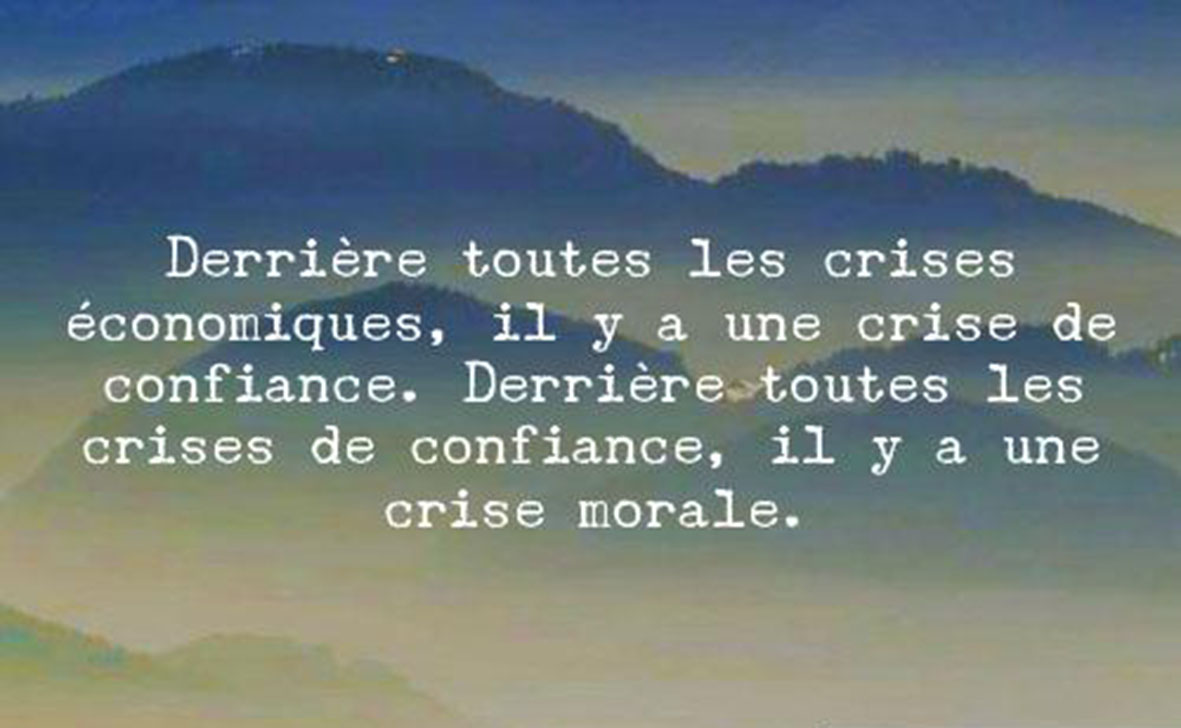Y a-t-il une crise morale en Occident, de nos jours ?
D’aucuns nient l’existence d’une telle crise, en Occident, voire la possibilité de sa survenue : ceux qui, profondément satisfaits de l’économie globale autant que de leur statut particulier, estiment que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Car l’hédonisme pour tous – du moins pour les nantis et ceux qui sont jugés dignes d’emprunter à moyen et long termes – procure cette béatitude de l’esprit, comparable à celle observée chez les riches bourgeois des Pays-Bas dès le XVIe siècle, chez ceux de Grande-Bretagne à partir du XVIIe et chez les « Lumières », au XVIIIe.
Certes, les philosophes éclairés se sont moqués de l’optimisme de Leibnitz, mais Voltaire, pour assurer le succès de son Candide, avait beaucoup forcé la note : l’Allemand cosmopolite était moins niais qu’on le prétendait.
Un bien-être et une richesse inconnus jusqu’alors combinaient leurs effets aux débuts du scientisme – cette prétention à tout expliquer par les sciences et les techniques – pour rendre résolument optimistes. L’Univers allait son chemin de façon immuable, étant réglé par le Grand Horloger ou le Grand Architecte, tandis que les progrès des connaissances et leur enseignement à un maximum de personnes devaient suffire à faire régner paix et prospérité pour les siècles des siècles.
Le dramatique tsunami de Lisbonne (qui toucha également Cadix et Séville) en 1755, puis quarante années de tourmente révolutionnaire et de guerres subintrantes, de 1776 à 1815 (soit la guerre d’indépendance des 13 colonies d’Amérique du Nord, puis la Révolution française étendue à presque toute l’Europe et les guerres de l’Empire qui boutèrent le feu d’Ibérie en Russie) se chargèrent de ramener élites et vulgum pecus à la réalité : il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais d’Âge d’Or pour l’humanité.
En réalité, il n’existait pas de crise morale, en Occident, en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, mais une crise d’autorité, ce qui est tout différent. La bourgeoisie, la petite noblesse et le bas clergé, formant un ensemble de « talents » impatients de démontrer leurs capacités, voulaient avoir leur mot à dire dans l’administration du Bien commun, dans l’orientation des affaires publiques. Presque partout, au lieu d’un monarque, on eut bientôt quelques centaines de parlementaires roitelets, qui révélèrent surtout leur énorme capacité de nuisance.
Au nom des demoiselles Démocratie et Liberté – fausses pucelles –, on instaura un peu partout cette merveilleuse chienlit que les savants politologues nomment ochlocratie (« Gouvernement par la foule, la multitude, la populace ») et les hommes du commun appellent régime d’assemblée.
Vers 1830, le jeu politique – déjà fort compliqué en lui-même par les querelles de personnes – fut entièrement faussé par l’irruption du milieu (aux sens canaille et crapuleux du terme) de l’économie dans l’exercice du pouvoir. Certes, l’argent avait joué un énorme rôle dans le monde antique, mais le christianisme médiéval, puis l’absolutisme des monarques de droit divin avaient anéanti les prétentions dominatrices des plus riches.
À compter des années 1830, partout en Occident, la nouvelle trinité dominante – celle des financiers, des négociants et des entrepreneurs – domestiqua le milieu politique, composé bien davantage de parasites besogneux que d’hommes réellement dévoués à la gestion du Bien commun. Le menu peuple fut abandonné à la voracité des « libéraux », c’est-à-dire au capitalisme esclavagiste. Bientôt, on allait répandre des torrents de larmes sur le sort des esclaves noirs des USA, alors que le modernisme accouchait de quelque chose que l’Ancien Régime ignorait : un sous-prolétariat de travailleurs.
Une crise morale gigantesque, la pire que l’humanité ait connue, se préparait, essentiellement parce que des hommes honnêtes, intelligents et pondérés ne furent pas écoutés. Charles Fourrier, Pierre Proudhon, Léon XIII, Thomas Carlyle et d’autres tentèrent d’ouvrir les yeux des moins sots de leurs contemporains. Ce fut l’époque où s’épanouissait « un mercantilisme sans âme… Quand je vois la bonne société dévergondée et des pauvres mourant de faim dans les grandes villes, j’ai la sensation d’une puissante vague d’iniquités déferlant sur le monde… Ne vous étonnez pas de ce qui arrivera dans les cinquante années à venir » (Alfred Tennyson en 1886).
La populace, reine des scrutins, abêtie par la propagande de haine des classes autant qu’abrutie par l’alcool, se laissa berner par les hérauts de la guerre sociale, Marx, Engels et leur séquelle, qui ne connurent leur heure de gloire qu’une fois achevé le désastre. La crise d’autorité de la fin du XVIIIe siècle avait débouché sur une crise d’adolescence, qui se termina l’automne de 1914, lorsqu’on s’aperçut que les roitelets étaient aussi imbéciles que les résidus de l’autocratie : ils avaient déclenché le processus irréversible du déclin de l’Europe.
Du coup survint le chaos, révélant cette crise morale qui couvait depuis le milieu du XIXe siècle, aussi déstabilisante que celle observée aux IVe et Ve siècle, dans l’Empire romain, lorsque les citoyens, amollis, aveulis et transformés en brebis par le christianisme, estimaient au-dessous de leur dignité de défendre les valeurs romaines antiques.
La crise morale des années 1915-1939 vit s’affronter comme jamais auparavant l’antagonisme des individualistes, nimbés du label « Libéralisme », et des idéalistes de l’effort collectif, qui tout naturellement en revinrent au totalitarisme antique. Tant il est vrai qu’un idéal collectif, religieux ou politique, débouche immanquablement sur l’exigence du don intégral – corps et esprit – du fidèle.
1945 et 1990 furent les millésimes de fin des grandes aventures collectives du XXe siècle. Le triomphe de l’ultra-capitalisme, soit l’imposition de l’économie globale à la planète et de la soumission absolue du pouvoir politique au pouvoir financier, marqua le triomphe de la conception individualiste, hédoniste et naïvement sentimentale de la vie humaine. Le problème économique et l’espérance eschatologique mises à part, on en revenait à l’extrême niaiserie des premiers siècles de triomphe du christianisme.
Toutefois, il est absolument évident qu’il existe un gouffre conceptuel infranchissable entre un Soros (et consorts) et un Constantin Ier, Imperator et Basileus.
De nos jours, les maîtres sont multiples ; ils se jalousent mutuellement (tant pis pour les complotistes : pas de complot possible, sans un minimum d’entente préalable entre Divas) ; ils n’ont aucun programme sur la longue durée, seulement des intérêts à court et moyen termes ; enfin, ils sont spirituellement aussi vides qu’une citrouille d’Halloween et n’ont rien de transcendant à offrir.
Les soi-disant élites universitaires et académiques occidentales (les politiciens ne firent qu’exceptionnellement partie de l’élite culturelle des Nations) paraissant bonnes à jeter aux oubliettes de l’histoire, les Nations d’Occident sont déboussolées. En témoigne une instabilité politique et, parallèlement, le retour en force des nationalismes, ce qui témoigne constamment d’un besoin de retour aux valeurs ancestrales.
Oui, il y a crise de civilisation, parce que les Nations sont bouleversées par la déification de la fortune (autrefois, on eût évoqué Mammon, mais le degré de culture en Occident ayant chuté de façon extraordinaire depuis le début de l’ère globalo-mondialiste, qui se souvient de cette divinité maléfique proche-orientale ?)…
Vous avez aimé cet article ?
EuroLibertés n’est pas qu’un simple blog qui pourra se contenter ad vitam aeternam de bonnes volontés aussi dévouées soient elles… Sa promotion, son développement, sa gestion, les contacts avec les auteurs nécessitent une équipe de collaborateurs compétents et disponibles et donc des ressources financières, même si EuroLibertés n’a pas de vocation commerciale… C’est pourquoi, je lance un appel à nos lecteurs : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS DÈS MAINTENANT car je doute que George Soros, David Rockefeller, la Carnegie Corporation, la Fondation Ford et autres Goldman-Sachs ne soient prêts à nous aider ; il faut dire qu’ils sont très sollicités par les medias institutionnels… et, comment dire, j’ai comme l’impression qu’EuroLibertés et eux, c’est assez incompatible !… En revanche, avec vous, chers lecteurs, je prends le pari contraire ! Trois solutions pour nous soutenir : cliquez ici.
Philippe Randa,
Directeur d’EuroLibertés.