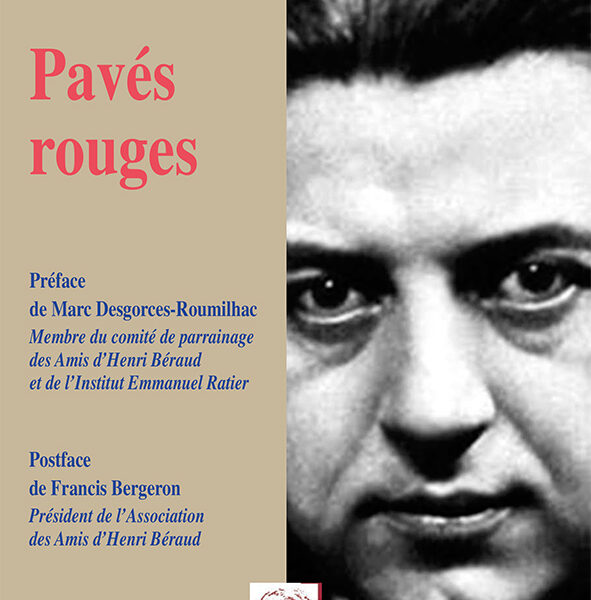6 février 1934… Réédition de « Pavés rouges », le célèbre pamphlet d’Henri Béraud
Préface de Marc Desgorces-Roumilhac (Membre du comité de parrainage des Amis d’Henri Béraud et de l’Institut Emmanuel Ratier) à la réédition par les éditions Déterna de Pavés rouges.
« Jusqu’au massacre du 6 février 1934, notre écrivain lyonnais se disait homme de gauche. Cet évènement va le faire évoluer. “Je n’aspire pas davantage à être un homme de droite”, écrit-il dans les pages d’introduction à Pavés rouges. Mais dans les faits, Béraud est désormais pleinement converti à la primauté du patriotisme français sur toute autre considération, rejoignant ainsi les positions de certains de ses adversaires d’hier »
(extrait de la postface de Francis Bergeron, Président de l’association rétaise des amis d’Henri Béraud).
Quatre-vingt-dix ans plus tard, il est pertinent, on pourrait même dire largement temps, d’éditer à nouveau Pavés rouges. Il ne fallait pas attendre 2034, soit la symbolique du siècle écoulé, pour mettre ce texte, en réalité ces textes juxtaposés, mais formant un ensemble cohérent et fort, à la disposition du plus grand nombre de nos contemporains.
Certes quelques bibliophiles heureux ou autres chineurs méthodiques disposent de l’édition de 1924 parue aux Éditions de France. Joli nom de raison sociale ; soit dit en passant, pour une maison qui publiait déjà Béraud depuis Le bois du templier pendu jusqu’à la fameuse trilogie des Ce que j’ai vu (Moscou, Berlin, Rome, auxquels témoignages il faut ajouter Vienne, clef du monde). En passant par La gerbe d’or et Le flâneur salarié, entre autres chefs-d’œuvre. Une histoire de fidélité, scellée par le succès, entre un auteur et un éditeur.
Beaucoup de livres de Béraud ont été réédités depuis sa condamnation, puis sa mort. Des cohortes déjà en âge de lire avant la iie guerre mondiale ont pu ainsi retrouver l’écrivain le plus vendu de l’entre-deux-guerres. Mais surtout a été touché un autre public, plus jeune, n’ayant pas connu cette époque ni celle de 1940-45. Un nouveau lectorat qui a pu découvrir le journaliste et l’auteur que l’Épuration avait non seulement condamné à la peine capitale, mais encore – et c’est bien plus terrible pour un auteur – à la mort, par l’oubli cyniquement organisé.
Or Pavés rouges n’a jamais, jusqu’à l’édition que vous tenez entre les mains, été réédité en tant que tel. Les éditoriaux de Gringoire qui le composent ont bien été repris, avec d’autres couvrant différentes époques. Toutefois ces parutions sont restées confidentielles, au sein de cercles eux-mêmes fort restreints. De sorte que le livre lui-même, qui dépasse largement la simple compilation d’articles de presse, demeurait inaccessible au plus grand nombre. Il est vrai que Pavés rouges inaugurait une série d’ouvrages que Béraud continua d’écrire ensuite avec une plume acérée au service d’une verve acide. Au point que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier Pavés rouges, Trois ans de colère, Popu-roi, Sans haine et sans crainte, du vocable de pamphlets au sein de la bibliographie béraldienne. On est pourtant loin de la brutalité des pamphlets céliniens de la même époque. Il faut reconnaître cependant que ces chroniques ne sont pas rédigées avec une langue de bois, fond comme forme. Il flotte concomitamment une odeur de soufre depuis quatre-vingts ans sur tous les écrits virulents dont les auteurs ont été condamnés ou inquiétés à la Libération. C’est vraisemblablement pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour Pavés rouges. C’est à la fois dommage et tant mieux.
Dommage, car nous avons été longtemps privés de l’intelligence du propos et de la qualité de la langue de Béraud, figées telles quelles, au cours de l’année 1934. Tant mieux, dans la mesure où la période contemporaine, celle que nous vivons autour de l’année 2024, présente de sérieuses analogies avec les années 1930. On connaît l’adage l’Histoire ne se répète pas. Certes. Une formule cependant répond : « il lui arrive de bégayer ». C’est bien ce qui semble se passer dans les années 20 du XXIe siècle, en miroir des années 30 du xxème. Ouvrons clairement les yeux, ce sont dans les deux cas, au-delà du cliché, des moments de changements importants et durables. Tant dans la situation intérieure qu’extérieure.
En effet Pavés rouges, sorte de haut-le-cœur de Béraud face au drame sanglant du 6 février 1934, c’est en réalité la chronique des conséquences inéluctables de l’an précédant. Car 1933 représente une année pivot, c’est l’instant où l’on bascule de l’après-guerre à l’avant-guerre. Robert Brasillach ne nous aurait pas démenti. Béraud l’a vécu, ressenti, compris. De même que le XIXe siècle ne s’arrête pas en 1900, mais plutôt en septembre 1914, de même que le xxe siècle ne commence vraiment qu’en 1918, voire avec les traités de 1919-1920-1921, de même l’année-césure 1933 court de décembre 1932 à février 1934. Des élections allemandes qui amèneront l’avènement au pouvoir d’Hitler à Berlin le 30 janvier 1933, aux événements sanglants à Paris le 6 février 1934. Ce qui est remarquable avec Béraud, c’est qu’il ait possédé la capacité de saisir immédiatement la portée de ces instants, en combinant cet instinct avec le pressentiment des conséquences engendrées à terme.
Ce sens si aigu de l’observation des hommes et des sociétés que développait Béraud l’amène fatalement à effectuer une introspection de son propre corpus idéologique. Pavés rouges marque de façon emblématique son basculement politique. Il quitte définitivement les présupposés de fond et les rituels de forme de la pensée de gauche. En apparence il s’en défend, continuant à se définir comme de gauche pour le côté social. Plus loin il récuse, avant que Doriot ne s’empare de l’idée, le clivage gauche-droite. On ne nous empêchera pas de penser qu’il s’agit de protestations formelles. Parce que, si la logique marxiste de la division des sociétés en classes nécessairement antagonistes – et partant l’assignation idéologique de leurs membres en fonction de leurs appartenances – avait eu quelque consistance à ses yeux, Béraud n’aurait pas accepté de paraître l’anti-exemple. De personnifier le cas paradoxal, comme on dit en médecine. Il en était tellement conscient qu’il nous confie, par ce sens de l’anticipation qui l’a souvent habité, que désormais il sera fatalement taxé de fasciste. Alors qu’il ne regarde ni du côté de Rome ni du côté de Berlin, pas plus que du côté de Moscou. Au demeurant il répond à l’avance aux accusations qu’il imagine comme inéluctables : « les fascistes, c’est vous. »
Remarquons au passage qu’au début des années 30 ce n’est pas lui qui change le plus. C’est plutôt la gauche qui rompt l’esprit d’union sacrée qui perdurait bon an mal an, de façon explicite ou plus indicible, depuis la Grande Guerre. Les communistes surtout. Les socialistes attendront pour la plupart d’entre eux les années 80 pour trahir le credo prolétarien, et les années 2000 pour renouer avec l’internationalisme, mais en mode dépassement des États-Nations. Ce n’est pas encore de saison vers 1930 ; toutefois les similitudes avec les années 2020 sont perceptibles.
En faisant réapparaître au grand jour sa préférence pour le sentiment prioritaire d’appartenance à une classe plutôt qu’à la nation, la gauche des années 1920 et 1930 dévoile clairement son projet consubstantiel. Lequel ravale la France et les Français au second plan, après la lutte des classes. Ce qui choque et scandalise Béraud.
Pavés rouges nous aide à comprendre sa mue, en politique intérieure comme extérieure. Béraud était trop intelligent, trop indépendant, pour rester prisonnier de ses origines intellectuelles et sociales. Il avait vu la réalité de la vraie vie, à Lyon, à Paris, à Moscou, partout où il avait flâné.
Cependant, tout en quittant progressivement dans les années 30 la structure mentale de la gauche, il ne se rallie pas pour autant aux slogans des diverses factions de droite du moment. Il s’en méfiait, il ne s’y reconnaissait pas.
Dès lors comment le repérer (ceci lui importait peu au demeurant) sur l’axe traditionnel de césure politique ? Béraud nous donne la réponse, simple, de par ses positions et les attendus qui les soutiennent : sa ligne demeure le patriotisme, les intérêts de la France et des Français d’abord. Il nous écrit lui-même en prologue : « s’il faut obéir à des consignes, alors non, je ne suis pas un homme de gauche. J’ajoute que je n’aspire pas davantage à être un homme de droite. Ni un homme du milieu. Il me suffit d’être un homme tout court. »
Son honnêteté intellectuelle est patente lorsque lui, républicain de gauche autoproclamé, rend hommage à Maxime Real del Sarte, royaliste de droite notoire. En 1934, contrairement à ce que certains ont cru le déceler et d’autres l’en accuser, il ne passe pas de gauche, à droite. On peut toutefois dire qu’à partir de là il exercera son point de vue, de droite.
Ce sera vrai aussi dans son analyse de la politique étrangère. À partir de 1934, Béraud discerne comment les démocraties, en fait l’Angleterre et la France, imbues de leurs empires respectifs et inquiètes des ambitions de l’Italie en matière coloniale, vont jeter cette dernière dans les bras de l’Allemagne. Alors que l’Italie fasciste et son Duce attendaient plus de faveurs de leur côté que de celui du führer et de l’Allemagne national-socialiste. Un tel aveuglement, renforcé par les clameurs surjouées du théâtre antifasciste de l’époque, attriste Béraud. Pareille bêtise le révolte.
Tout rapprochement avec l’attitude de l’Union européenne à partir de 2022 vis-à-vis de la Russie à propos de l’Ukraine, avec renforcement des liens Moscou-Pékin et montée en puissance des BRICS à la clef, ne serait pas fortuit. Décidément ; qu’il s’agisse de politique interne ou étrangère, les années 1930 de Béraud possèdent des points communs avec nos années 2020. C’est en cela également que Pavés rouges et intéressant à lire aujourd’hui.
Mais Pavés rouges c’est d’abord, rappelons-le, la reprise, retravaillée, d’articles parus à l’époque dans Gringoire. Avec le génie éclatant d’une plume qui à la fois commente l’actualité la plus chaude et la met en perspective grâce à un point de vue qui prend de la hauteur, dans le temps comme dans l’espace. Nous sommes loin de la fadeur d’un livre de journaliste.
Nous est évité aussi le piège d’une collection purement thématique ou chronologique d’articles. Nous bénéficions d’une pensée nourrie et illustrée par l’actualité. Les portraits de Daladier et de Frot paraissent d’une vérité impitoyable, on songe au Rebatet des Décombres. Idem pour les images des parlementaires, dont les accointances ou les appartenances sont évoquées avec de savoureuses périphrases ou des allusions connotées (l’acacia pour les Radicaux, par exemple). Cette finesse rejoint le goût d’une belle langue, sans affectation. Toute en correction et maîtrise de l’expression.
Nous trouvons aussi dans cet ouvrage non seulement une analyse lucide de l’abîme dans lequel la iiie République est alors en train de plonger la France, mais encore du sursaut qu’aurait dû provoquer la fusillade du 6 février. Nous avons droit à une revue saisissante des syndromes de la décadence entamée depuis la fin de la Grande Guerre : « Nous payons à sa juste valeur l’arriéré de quinze ans de complaisance, de scepticisme, d’immoralité […] nous payons l’après-guerre, l’inflation, le cambisme , les jazz nudistes, les cocktails-partouzes, les films de gangsters, les aigrefins renfloués, les acquittements triomphaux, les vieilles garçonnes, les dindes rouges, les pédérastes littéraires et les stupéfiants à bon marché ». Très justement Béraud parle de l’affaire Stavisky comme de l’un des symptômes, et non comme de la cause elle-même de la crise de janvier 1934 qui entraînera les tragiques événements de février.
Concernant précisément les responsabilités morales, politiques et économiques de la IIIe République dans la décadence de la France, la clairvoyance de Béraud, pourtant contemporain immergé dans l’époque, témoigne d’une acuité étonnante, parfaitement exposée dans Pavés rouges. À croire qu’en 1934, il a connu personnellement la déroute impériale de 1870 et les tristes années qui l’ont suivie. À penser que, en 1934, il a vécu de façon prémonitoire la débâcle de 1940… il est saisissant à cet égard de comparer les critiques qu’il fait des tares de la IIIe avec l’instruction à charge des procès de Riom. On dirait une annonce, sept ans à l’avance, des réquisitoires ! On pense aussi aux thèmes abordés dans certains discours fondateurs de l’esprit de l’Etat français, prononcés à la radio ou lors de ses déplacements dans les provinces par le Maréchal, en 1940 et 1941.
On pourrait aussi, en forçant le trait, prêter à Béraud le même don de divination dans son anglophobie, qui transpire dans Pavés rouges. Il la revendique. Il l’explique. Tant et si bien que l’on en viendrait à croire qu’il a dès 1934 prévu Dunkerque et Mers-el-Kébir. Ceci dit, Jeanne d’Arc, Fachoda et autres roueries d’Albion suffisaient à alimenter son sentiment sur le sujet. Notons au passage, ironie de l’Histoire et démenti factuel des accusations infâmantes qui le feront néanmoins injustement condamner lors de l’Epuration, que jamais cette anglophobie ne s’accompagne d’une quelconque germanophilie.
Tel quel, dans le respect intégral de son édition originale, Pavés rouges constitue un témoignage irremplaçable sur le moment décisif que constitue le tournant des années 1933 et 1934. Ce contexte daté fait de plus résonner quelques événements contemporains de la période 2024 comme en écho.
Pavés rouges, d’Henri Béraud, éditions Déterna, collection « Documents pour l’Histoire », préface de Marc Desgorces-Roumilhac, Membre du comité de parrainage des Amis d’Henri Béraud et de l’Institut Emmanuel Ratier ; postface de Francis Bergeron, Président de l’Association des Amis d’Henri Béraud, 130 pages, 21 €. Pour commander ce livre, cliquez ici.
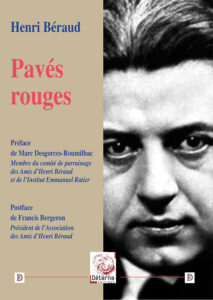
Pavés rouges, d’Henri Béraud, éditions Déterna, collection « Documents pour l’Histoire », préface de Marc Desgorces-Roumilhac , Membre du comité de parrainage des Amis d’Henri Béraud et de l’Institut Emmanuel Ratier ; postface de Francis Bergeron, Président de l’Association des Amis d’Henri Béraud, 130 pages, 21 €.
EuroLibertés : toujours mieux vous ré-informer … GRÂCE À VOUS !
Ne financez pas le système ! Financez EuroLibertés !
EuroLibertés ré-informe parce qu’EuroLibertés est un média qui ne dépend ni du Système, ni des banques, ni des lobbies et qui est dégagé de tout politiquement correct.
Fort d’une audience grandissante avec 60 000 visiteurs uniques par mois, EuroLibertés est un acteur incontournable de dissection des politiques européennes menées dans les États européens membres ou non de l’Union européenne.
Ne bénéficiant d’aucune subvention, à la différence des médias du système, et intégralement animé par des bénévoles, EuroLibertés a néanmoins un coût qui englobe les frais de création et d’administration du site, les mailings de promotion et enfin les déplacements indispensables pour la réalisation d’interviews.
EuroLibertés est un organe de presse d’intérêt général. Chaque don ouvre droit à une déduction fiscale à hauteur de 66 %. À titre d’exemple, un don de 100 euros offre une déduction fiscale de 66 euros. Ainsi, votre don ne vous coûte en réalité que 34 euros.
Philippe Randa,
Directeur d’EuroLibertés.
Quatre solutions pour nous soutenir :
1 : Faire un don par paypal (paiement sécurisé SSL)
Sur le site EuroLibertés (www.eurolibertes.com), en cliquant, vous serez alors redirigé vers le site de paiement en ligne PayPal. Transaction 100 % sécurisée.
2 : Faire un don par chèque bancaire à l’ordre d’EuroLibertés
à retourner à : EuroLibertés
BP 400 35 – 94271 Le Kremlin-Bicêtre cedex – France