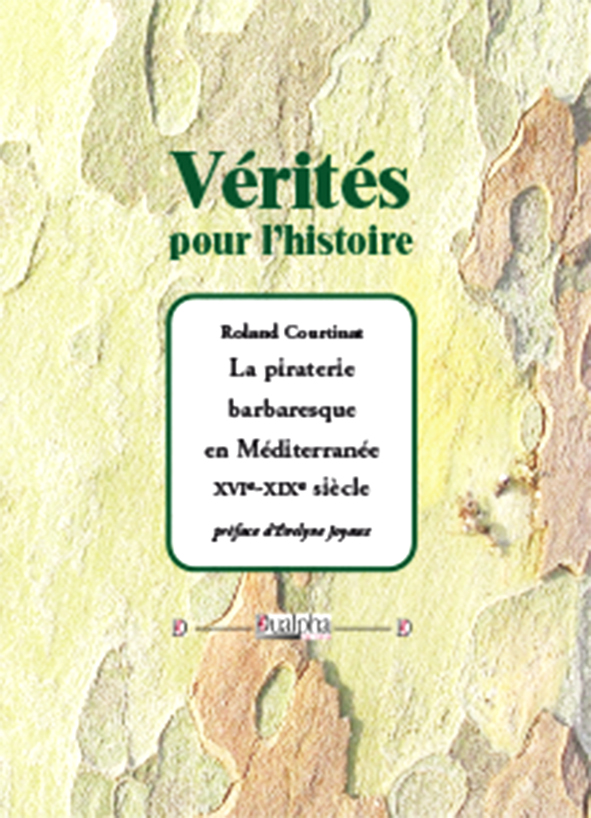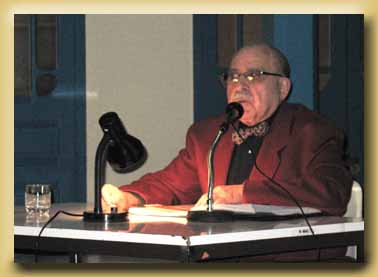Lorsque les djihadistes se livraient à la piraterie et à l’esclavage
Par Fabrice Dutilleul« Pour les pirates maures, au début, la piraterie est plus une forme de djihâd,
une sorte de guerre sainte maritime contre les chrétiens, qu’une source de profits »
Entretien avec Roland Courtinat, auteur de « La piraterie barbaresque en Méditerranée XVIe-XIXe siècle », préface d’Évelyne Joyaux. (éditions Dualpha)
(Propos recueillis par Fabrice Dutilleul)
Comment est apparue la piraterie barbaresque ?
Après la chute de Grenade en 1492, la Reconquista est terminée. Je montre comment beaucoup de Maures refusent de vivre dans un monde chrétien et se réfugient en Afrique du Nord, base de départ de leurs ancêtres, le cœur rempli de haine contre la chrétienté. Ils n’ont qu’un seul désir : celui de se venger. Sur place, le peuple berbère souffre de la défaite de l’islam andalou. L’émotion berbère, attisée par les marabouts, explique la piraterie, car faute de pouvoir lever des armées à la reconquête de l’Andalousie, les navires maures vont semer la terreur et la désolation sur les côtes ibériques.
Vous démontrez qu’initialement, leur objectif n’était donc pas le simple brigandage ?
Pour les pirates maures, au début, la piraterie est plus une forme de djihâd, une sorte de guerre sainte maritime contre les chrétiens qu’une source de profits. J’en apporte les preuves. Ce n’est que plus tard, sous l’impulsion des Turcs, que la piraterie deviendra brigandage et les soldats de l’islam des pirates. L’essor pris par la piraterie étant devenu redoutable, les pirates s’associent entre eux, puis avec le souverain turc d’Alger. C’est l’ère de la piraterie barbaresque. Avec l’accord du souverain concerné, la piraterie devient alors une guerre maritime de prééminence religieuse entre l’islam et la chrétienté. Mais ce n’est pas la seule motivation, car apparaît aussi la notion de profit. La Régence d’Alger ne possède aucune économie publique et ne peut subsister que par la piraterie qui lui procure l’équilibre de son budget par la vente des marchandises capturées sur les navires arraisonnés, et, bien sûr, la vente des esclaves.
Vous décrivez également ce qu’était la Régence d’Alger ?
Au début du XVIe siècle, le Maghreb est une mosaïque de roitelets plus ou moins indépendants. Certains même payent tribut à l’Espagne. Après bien des péripéties, Kheir-ed-Din, l’un des frères Barberousse se rend maître d’Alger. Très habilement, il offre au sultan de Constantinople la souveraineté de son nouveau territoire. Le sultan accepte d’autant plus aisément que cette suzeraineté lui permet de mettre un pied dans le bassin méditerranéen occidental. C’est ainsi qu’Alger devient la Régence d’Alger, possession turque, qui le restera jusqu’en 1830, soit 312 ans plus tard.
Vous parlez dans votre livre de la Taïffa des Raïs…
La plupart de ces capitaines-pirates, les raïs, sont des renégats issus des provinces misérables du pourtour méditerranéen. D’origine chrétienne ayant renié leur foi, ils sont recrutés par leurs aînés, souvent leurs ravisseurs. Le frère bénédictin de Haëdo, lui-même captif à Alger, dénombre en 1612, parmi les 35 principaux raïs d’Alger, 24 d’origine chrétienne. Ils sont réunis dans une corporation, la Taïffa, qui, avec l’Odjak de la milice des janissaires, forment les deux institutions dominatrices dans la Régence turque d’Alger. C’est la Taïffa qui, par ses prises, entretient la prospérité de la ville et de ses finances. C’est la Taïffa qui élit ou exécute à sa guise les deys d’Alger.
Dans votre livre vous présentez l’esclavage comme le corollaire de la piraterie…
Il n’y a pas d’esclavage sans piraterie. Le pirate fait des prisonniers qu’il vend ensuite sur le marché des esclaves ou qu’il garde dans sa part de prise pour compléter les rameurs de sa chiourme. En 1580, de Haëdo estimait à 25 000 le nombre d’esclaves chrétiens détenus à Alger. Le père trinitaire Dan en dénombrait 30 000 en 1634. Qui le rappelle de nos jours ?
Quand disparaît la piraterie barbaresque ?
Le dernier acte de piraterie remonte à 1823. L’Europe ne pouvait plus supporter la piraterie et l’esclavage en Méditerranée, champ d’action propice aux rapines, à la traite des femmes, au trafic des esclaves que je n’hésite pas à rappeler dans mon livre. Presque toutes les interventions navales contre la Régence d’Alger s’étaient soldées par des échecs. Ce n’est qu’à la réunion des puissances européennes à Aix-la-Chapelle en 1819, que le congrès mandate les gouvernements anglais et français pour notifier au dey d’Alger la volonté de l’Europe de voir supprimée la piraterie. Le dey d’Alger se moque de cet ultimatum. Après le « coup de l’éventail » donné au consul de France à Alger en 1827, le gouvernement français décide d’une intervention militaire. Contrairement à l’imagerie d’Épinal qu’on veut bien lui donner, l’expédition française n’est donc pas un honteux prétexte pour coloniser une contrée paisible et sans défense.
Reste-t-il encore des traces de ces pirates ?
La présence française s’est faite en Algérie avec des généraux qui avaient servi dans les armées de la Révolution, puis de l’Empire. De Cadix à Moscou, ces soldats français libéraient les peuples opprimés d’Europe au nom de la Liberté et des Droits de l’Homme. Arrivés à Alger, leur premier acte a été de détruire les quartiers pénitentiaires tristement célèbres, se souciant peu de la conservation de vestiges qui symbolisaient à leurs yeux la société médiévale qu’ils avaient partout combattu.
En revanche, les pirates se sont durablement installés en Provence pendant la totalité du Xe siècle. On leur doit le Cannet des Maures, le massif des Maures, la forêt des Maures. Leur néfaste influence est également palpable dans un pays comme l’Italie à vocation maritime avec un immense balcon, tant sur la Méditerranée que sur l’Adriatique, et qui a finalement renoncé à cause de la piraterie.
La piraterie barbaresque en Méditerranée XVIe-XIXe siècle, éditions Dualpha, collection « Vérités pour l’Histoire », dirigée par Philippe Randa, 348 pages, 35 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.
Navigation de l’article
Collaborateur du site Francephi.com, spécialisé dans les entretiens politiques, historiques et littéraires.